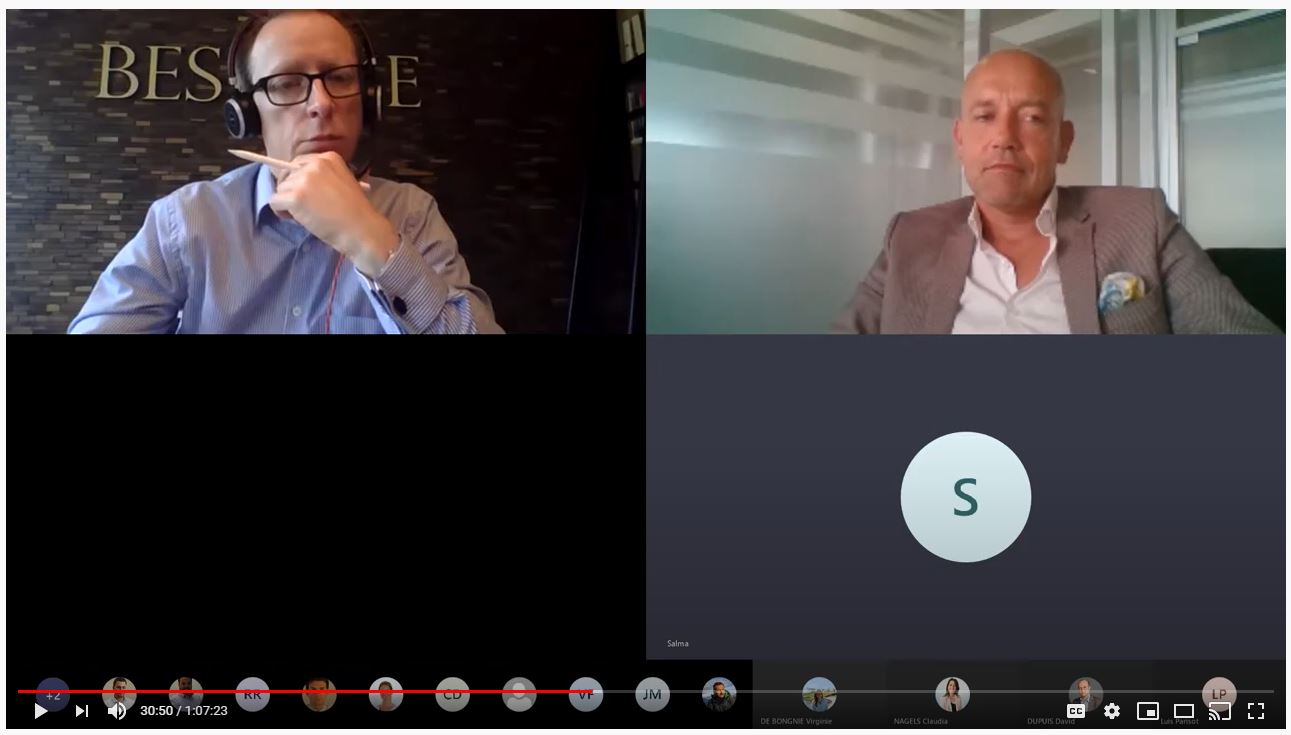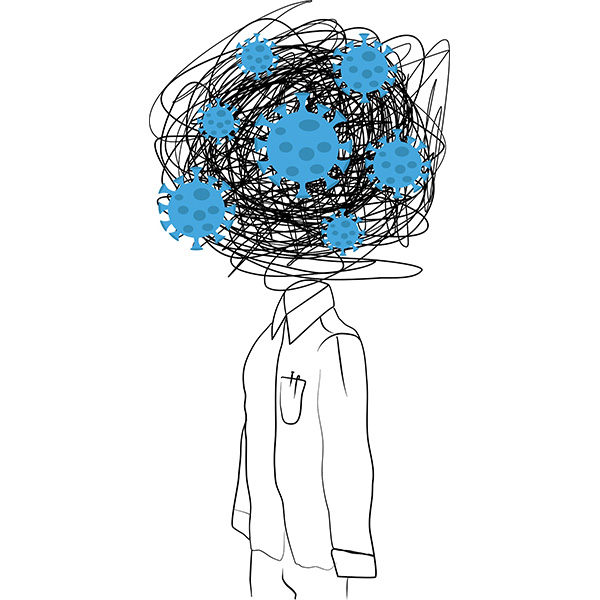La déprime n’est pas une fatalité de la rentrée
La rentrée et la crise du Covid risquent de faire des dégâts sur le moral des collaborateurs. Mais le combat n’est pas perdu d’avance. Comment éviter la petite déprime de saison pour ses collaborateurs et soi-même ? Que mettre en place dans ses équipes ? A quoi faut-il prêter attention ? Déprime, dépression, de quoi parle-t-on ? Combien de travailleurs sont concernés ? Quelles sont les obligations légales d’une entreprise en la matière ? Cette newsletter amène quelques éléments de réponse.
En Belgique, le nombre de personnes souffrant de dépression (burn-out compris) est estimé à 1.200.000. Un nombre qui a doublé en 10 ans et qu’on diagnostique surtout chez les femmes plus promptes à pousser la porte d’un spécialiste.
Un patient sur 5 se situe dans la tranche d’âge 51-60 ans et, plus alarmant, les jeunes enfants (âgés de 0 à 10 ans) sont désormais touchés par cette maladie. Selon l’Inami, 4.000 d’entre eux sont en effet traités pour dépression en Belgique. Des chiffres affolants qui sont malheureusement renforcés par la crise du Covid.
Cette dernière a en effet un impact sur la santé mentale et sociale des Belges. « On observe par exemple que 8 % des personnes de 18 ans et plus ont indiqué qu'elles avaient sérieusement pensé à mettre fin à leurs jours au cours des 3 derniers mois, et 0,4 % ont même tenté de le faire », ressort-il d'une enquête de Sciensano réalisée auprès d'un échantillon de 34.000 personnes en juin 2020.
De quoi parle-t-on ?
La santé des Belges, en général, et des travailleurs, en particulier, doit donc être au centre des attentions. Mais, quand on parle de déprime ou de dépression, de quoi parle-t-on exactement ? Le site de référence en matière de santé en France (doctissimo.fr) apporte la nuance suivante : « La déprime ou le fait d'être déprimé est un état passager, contrairement à la dépression qui se caractérise par des symptômes caractéristiques et durables. La différence entre les deux termes pourrait aussi se comparer à la différence entre un babyblues et une dépression post-partum chez la femme après l’accouchement ».
Dans le cadre de notre newsletter, nous explorons la déprime ou le coup de mou, la dépression étant une maladie qui demande un suivi médical plus important et qui est souvent synonyme d’absence au travail (de moyenne ou longue durée).
Comment détecter une déprime ?
En fonction des personnes, les symptômes d’une déprime ou d’un passage à vide sont différents. Une personne joyeuse qui l’est moins est peut-être dans un moment plus délicat de sa vie, alors qu’une personne qui n’est pas joyeuse et qui est fidèle à elle-même sera peut-être en grande forme mentale.
Néanmoins, il est possible de faire différentes observations. La toute première est un changement d’humeur relativement prolongé. Les troubles de l’appétit sont également à surveiller. Tout comme une surconsommation (parfois addictive) de produit nocif (cigarettes, alcool, médicaments, sucre...). Un quatrième point d’attention est l’état de fatigue général. Quelqu’un qui se plaint de mal ou de ne pas dormir est à surveiller. Autre point, enfin, la dévalorisation ou la perte de l’estime de soi. D’autres symptômes sont parfois avancés comme les troubles de la mémoire, une agressivité à l'encontre des collègues ou une modification de l’activité (d’hyperactif à léthargique ou inversement).
Et on fait quoi ?
L’entreprise ou le DRH n’a évidemment pas le monopole des solutions. Face à quelqu’un qui est un peu déprimé, la réponse est globale (famille, amis, médecin…). Il ne faut cependant pas sous-estimer le rôle que peut jouer l'entreprise pour ses collaborateurs. Ils y passent en effet de nombreuses heures par jour (la majorité) et surtout, un collaborateur déprimé est moins motivé et aura un impact négatif sur son activité et sa productivité, voire sur ses collègues ou sur l'entreprise.
Plusieurs éléments sont à envisager dont deux essentiels en cette rentrée. Premièrement, les rumeurs, la mauvaise communication… engendrent stress, malentendus et jouent directement sur les facteurs qui amènent des coups de mou. Il est donc essentiel que toute personne dans l’entreprise, direction, RH, syndicat, travailleurs… soit correctement informée sur la vie de la société afin que chacun y trouve sa place. Ensuite, autre source de tension et mal-être, le flou sur les objectifs des uns et des autres. Là aussi, il est essentiel en cette rentrée de bien s’assurer que chaque collaborateur sait ce qui est attendu de lui et connaisse les moyens dont il dispose pour y arriver.
Que dit la loi ?
En Belgique, l’employeur est obligé d’évaluer les risques psychosociaux (RPS) dans son entreprise et de mettre en place des mesures de prévention afin de les éviter. Il doit donc intégrer la prévention des RPS dans sa politique de prévention des risques professionnels. Tout employeur est obligé de mener une politique dans son entreprise pour promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail. Cette politique s’appuie sur le principe de l’analyse des risques. Cette dernière permet à l’employeur de développer des mesures de prévention appropriées pour éliminer les dangers ainsi que prévenir et limiter les dommages.
Et évidemment, des initiatives « joyeuses »
En tant que DRH, plusieurs initiatives peuvent être prises pour amener plus de joie dans la société. Certains miseront sur un aspect ludique : mise à disposition de tables de ping-pong, de baby-foot, sorties entre collègues, team-building, apéro un soir par semaine (éventuellement en téléconférence en ces temps atypiques), etc.
D’autres miseront davantage sur le côté « facilité » : mise à disposition de repas, de soda, de conférences, d’avantages ou de services divers tels repassage ou nettoyage.
D’autres encore mettront en avant le côté sportif. Il est en effet prouvé que le sport engendre du bien-être à moyen terme et de façon durable pour les gens qui le pratiquent régulièrement. Sachez qu’il existe aussi des initiatives fédérales initiées par le gouvernement et qui permettent de combattre ce qui peut être défini comme « la fatigue d’être soi et cette incapacité à faire face à la vie qu’on mène ».
Enfin, si vraiment vous souhaitez revoir certains objectifs dans votre entreprise, vous pouvez également opter pour le recrutement d’un CHO (Chief Happiness Officer) qui, comme son nom l’indique, a pour mission de rendre les collaborateurs heureux en créant les conditions nécessaires à ce que chacun puisse trouver sa place tout en assurant une bonne productivité.