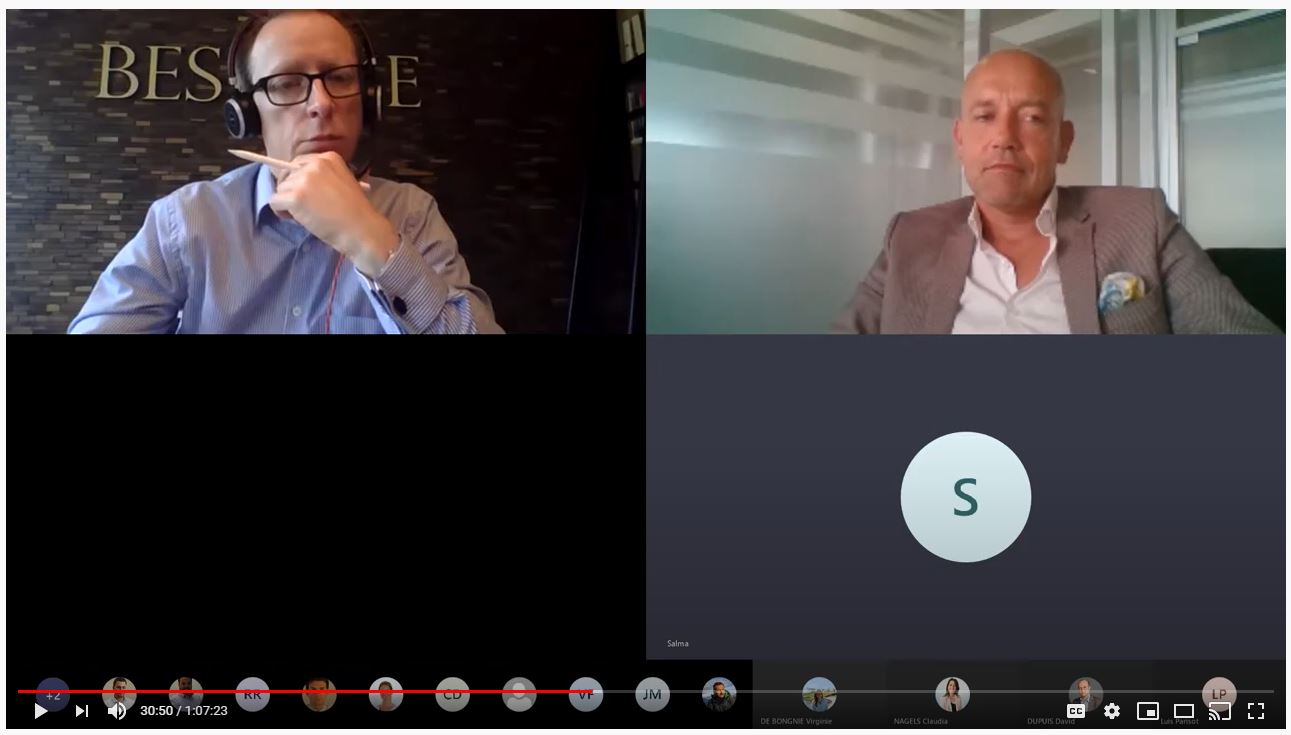Trop vieux, moins productif, largué par la technologie… Est-ce vraiment une question d’âge ?
Comment faire cohabiter plusieurs générations au travail ? L’âge a-t-il une influence sur les performances ? A-t-on une date de péremption en entreprise ? Travaille-t-on différemment selon notre âge ? Cette newsletter amène quelques éléments de réponses.
En Belgique, la perception de l’âge en entreprise est assez restrictive et stéréotypée. Pour beaucoup de Belges en effet, prendre de l’âge s’accompagne mal avec le travail. Plus nous vieillissons, plus nous serions susceptibles de quitter l’entreprise et de laisser de la place à une nouvelle génération. D’ailleurs, les chiffres sont très éclairants. Alors que le taux d'activité d’un Suédois de plus de 55 ans est de 80%, il n’est que de 45% chez nous. Pour le dire autrement, nous avons une culture de « sortie » assez ancrée qui fait que dès 55 ans, ceux qui peuvent, pensent (ou sont invités) à prendre leur retraite ou pré-retraite.
Nele De Cuyper, professeur en psychologie du personnel à la KULeuven, le confirme : « En Belgique, nous avons une culture de sortie précoce du marché de l’emploi. Combien de fois n’entend-on pas des gens dire : "quand est-ce que vous pourrez prendre votre retraite ?" » (source)
Moins jeune, moins productif ?
Une des raisons parfois évoquées est que l’âge est synonyme d’une baisse de la performance. Avec la vieillesse, on aurait moins de réflexes, moins d’idées, moins d’énergie. En fait, rien n’est moins faux. En 2015, l’Agence nationale française pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) a réalisé un étude comparative qui est encore aujourd’hui une référence en Europe (source). La conclusion est sans équivoque : « De façon générale, et contrairement aux représentations, les études relèvent que les pertes de capacités physiques ou cognitives dues au vieillissement « naturel » restent modérées jusqu’à 65-70 ans, et qu’elles sont compensées par l’expérience. À 60 ans, un salarié en bonne santé dispose encore de 80 % des potentialités dont il disposait à l’âge de 20 ans. »
Les différences de performance sont dans la plupart des cas plus marquées entre individus d'une même classe d'âge qu'entre personnes de classes d'âge différentes. Autre point mis en avant : ce sont surtout les conditions de travail et l’ambiance générale qui génèrent des problèmes de performance, pas l’âge.
Une affirmation que fait également Nele De Cuyper : « Le fait que les personnes âgées de plus de 55 ans devraient moins travailler est un mythe […] Le stéréotype persistant que les travailleurs âgés ne veulent plus rien apprendre est tout à fait incorrect. Ils s’informent d’une autre manière, sans doute moins formelle, mais font bel et bien des efforts pour rester en phase avec la société technologique actuelle. »
En conclusion, notre « date de péremption au travail » n’est pas liée à notre âge chronologique, mais à notre motivation, à notre envie et à l’énergie qu’on est prêt à consacrer à son travail.
4 générations de travailleurs
Aujourd’hui, quatre générations se côtoient dans les entreprises. La génération des Boomers II (personnes nées entre 1955 et 1965), la génération X (1966-1976), la génération Y (1977-1994) et la génération Z, aussi appelée millenials (1995-2012).
Dans les années 90, la grande majorité des travailleurs entraient dans une entreprise en espérant y passer le plus d’années possibles. La volatilité du marché de l’emploi, l’apparition des nouvelles technologies, les rapports sociaux (et parfois des rapports identitaires) ont totalement changé la donne. Concernant la technologie, ceux qui sont nés avant 1980 ont appris à l’utiliser et à l’inclure dans leur quotidien, alors que les personnes nées après 1980 ne la perçoivent même pas. Elle fait partie intégrante de leur vie. Elle est innée, intuitive et vitale.
Micro-pauses, rapport à la hiérarchie… D’autres différences capitales
Plusieurs autres différences sont marquées entre les générations. La première d’entre elle est le rapport à la hiérarchie. Alors que les plus de 40 ans respecteront scrupuleusement le rapport hiérarchique (même si le manager ne le mérite pas), les moins de 40 ans auront une vision horizontale du rapport à l’autorité. Et pour cause, issus de la première génération digitale où tout le monde a voix au chapitre (via les blogs, les réseaux sociaux…), ils considéreront plus facilement que chaque individu est égal au sein d’une entreprise.
Autre différence, le rapport au temps. Les plus de 40 ans ont appris à étudier et travailler dans un monde sans Internet où les recherches d’informations se faisaient dans des librairies ou en se renseignant auprès de collègues. Ils ont appris à attendre et à être patient. C’est très différent pour les moins de 40 ans qui ont grandi dans l’immédiateté des informations et la satisfaction instantanée des besoins de connaissances et de distraction.
Toujours considérant le temps, la génération Z (et un peu la Y) estimera avoir rapidement fait le tour d’un poste ou d’une société. Rester 3-4 ans dans une société sans changement est perçu comme une éternité. Les plus âgés, eux, mettront en avant leur longévité dans la société qu’ils considéreront comme une preuve de loyauté.
De même, les générations Z et Y ne vivent plus leur journée de travail en blocs. Pour eux, le classique 9-18 n’existe plus. Là où les plus âgés arriveront à l’heure, s’arrêteront à midi et reprendront jusque fin de journée en faisant une ou deux pauses, les générations X et Y travailleront de manière discontinue. Elles feront des micro-pauses pour checker un statut Facebook ou pour trouver un voyage sur Internet.
A l’inverse, elles consulteront leur boîte mail professionnelle le soir avant de dormir ou même très tôt au réveil. Enfin, le rapport à l‘espace est également différent. Aujourd’hui, les plus jeunes générations travaillent en « co-working » sur des « open space » ou encore en « remote » (télétravail). Ce qui est inné chez eux (je suis mon propre espace de travail), s’acquiert petit à petit pour les plus âgés.
Alors, comment faire cohabiter plusieurs générations ?
La réponse tient en mot : empathie. Le management doit en effet tout mettre en œuvre pour que les générations apprennent à se connaître et surtout comprennent le fonctionnement de l’autre génération en se mettant à sa place.
Quelques astuces pour les plus âgés. Premièrement, une réunion de travail, ce n’est plus 2h de papote autour d’une table. Pour les plus jeunes, ça peut être 20 minutes via Skype. Deuxièmement, les plus jeunes veulent être partie prenante des décisions et être acteurs de leur travail. Ils travailleront donc plus facilement en équipe. Troisièmement, il importe pour eux que la communication soit totale et transparente, veillez donc à bien partager les infos et à communiquer le plus clairement possible sur ce qui est attendu de qui, quand et comment.
Quelques astuces pour les plus jeunes. Premièrement, concernant les nouvelles technologies et leur utilisation, ne jugez pas l’incapacité des plus âgés, mais encouragez-les à apprendre et accompagnez-les dans cet apprentissage. Deuxièmement, privilégiez une simple discussion à un échange d’e-mails. Les plus âgés préfèrent nettement des échanges face à face lors desquels ils peuvent interagir. Enfin, il est essentiel pour les plus âgés de maintenir une certaine frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Les plus jeunes partagent depuis des années leur plat du midi sur Instagram, leurs photos de vacances sur Facebook et leur humeur sur Twitter. Pour les plus âgés, le jardin secret reste sacré.
Pour terminer, on notera que quel que soit notre âge, nous avons tous besoin d’être stimulés dans notre travail. Trop de travailleurs de plus de 55 ans sont parqués sur des voies de garage, sans évolution possible ni nouveaux projets. N’oublions pas que la clé pour avoir des travailleurs volontaires et engagés, quel que soit leur âge, est la motivation.